 C’est une de ces histoires vraies, une aventure hors norme comme en génère le sport. On se rappelle Rasta Rocket, comédie culte retraçant en 1994 la folle équipée des bobeurs jamaïcains aux JO de Calgary, en 1988.
C’est une de ces histoires vraies, une aventure hors norme comme en génère le sport. On se rappelle Rasta Rocket, comédie culte retraçant en 1994 la folle équipée des bobeurs jamaïcains aux JO de Calgary, en 1988.
Très récemment le documentaire Nice People racontait celle de migrants somaliens en Suède, qu’un idéaliste entraîne pour une participation à la Coupe du monde de hockey sur glace 2014 à Irkutsk.
Là il s’agit de ski de fond. Sam et Stéphane, deux amis d’enfance vivant en Savoie réussissent bien dans la fabrication de spatules haut de gamme, jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils imaginent un défi fou: qualifier Sam aux Jeux d’hiver où il représentera l’Algérie, le pays de son père.
Good Luck Algeria s'inspire du parcours semé d’embûches du frère du réalisateur Farid Bentoumi, Noureddine Maurice Bentoumi, qui a réussi au bout de deux ans à s'aligner à Turin en 2006 sous le drapeau algérien. Au-delà de l’exploit sportif, du vécu folklorique ou non, de ce combat de David contre Goliath à divers niveaux, le pari improbable de ce feel good movie qui amuse et émeut, va pousser ce franco-algérien à renouer avec une partie de ses racines.
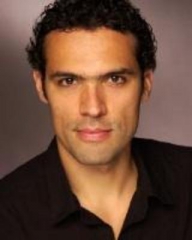 Né en France en 1976 d’un père algérien et d’une mère française, Farid Bentoumi qui vit aujourd’hui à Paris, a grandi en Savoie, suivant avec son frère un programme de ski-études. Il devient acteur et a notamment joué du Racine à La Chaux-de-Fonds et du Brecht à Vidy, nous révèle-t-il à l’occasion d’une rencontre à Genève.
Né en France en 1976 d’un père algérien et d’une mère française, Farid Bentoumi qui vit aujourd’hui à Paris, a grandi en Savoie, suivant avec son frère un programme de ski-études. Il devient acteur et a notamment joué du Racine à La Chaux-de-Fonds et du Brecht à Vidy, nous révèle-t-il à l’occasion d’une rencontre à Genève.
En 2006, il tourne un premier court-métrage, un second deux ans plus tard, ainsi qu'un documentaire sur sa famille qu’il estime raté. «Je n’ai pas fait ce que je voulais. Mais cela m’a permis de m’interroger sur ma binationalité ou plutôt ma biculture et m’a servi pour Good Luck Algeria".
ll a décidé de se lancer dans cette comédie politico-sociale où on retrouve Sami Bouajila, Franck Gastembide, Chiara Mastroianni et Hélène Vincent il y a cinq ans, y consacrant trois ans d’écriture.
«Sur fond de ski et de dépassement de soi, je brasse plusieurs thèmes autour de la famille. A la base, c’est le récit d’une mixité heureuse, une histoire d’amour, d’héritage, de transmission de valeurs, d’amitié, de fidélité et de sincérité. C’est aussi devenu un film qui lutte contre les clichés et tente de donner une autre image de l’immigration dont trop de gens ont une vision négative ».
Pour le rôle principal de Good Luck Algeria, essentiellement tourné en Italie, en Autriche et en Suisse, Farid a donc choisi Sami Bouajila, qui ressemble beaucoup à son frère Noureddine. «Ils ont la même carrure et de dos, c’est à s’y méprendre. C’était important pour les scènes de doublage. Mais Sami est un gros bosseur, il a appris à skier et la plupart du temps, c’est lui sur les lattes. Selon moi, il campe un vrai héros avec qui on a envie de se battre.»
A l‘affiche dans les salles de Suisse romande dès mercredi 30 mars.
 Le vingt-deuxième long-métrage d'André Téchiné est sans doute son meilleur depuis Les Témoins en 2007, où il brossait le portrait bouleversant d’une société en crise d'identité face au sida. Dans Quand on a 17 ans, qui fait évidemment écho aux Roseaux sauvages sorti en 1994, le réalisateur explore l’un de ses thèmes favoris, les brûlures de l’adolescence.
Le vingt-deuxième long-métrage d'André Téchiné est sans doute son meilleur depuis Les Témoins en 2007, où il brossait le portrait bouleversant d’une société en crise d'identité face au sida. Dans Quand on a 17 ans, qui fait évidemment écho aux Roseaux sauvages sorti en 1994, le réalisateur explore l’un de ses thèmes favoris, les brûlures de l’adolescence. Composé de trois parties coïncidant avec les trimestres scolaires menant au baccalauréat, le film n’est toutefois pas uniquement centré sur Tom et Damien. Son auteur s’intéresse aussi à leurs parents, au trio qu’ils forment avec Marianne. Il regarde tous ses personnages avec affection, montrant une communauté solidaire balayant les différences sociales ou les préjugés sexuels. Des comportements symbolisés par une Sandrine Kiberlain solaire, expliquant à son fils qu’il ne faut pas avoir peur et que tout s’efface quand on est amoureux.
Composé de trois parties coïncidant avec les trimestres scolaires menant au baccalauréat, le film n’est toutefois pas uniquement centré sur Tom et Damien. Son auteur s’intéresse aussi à leurs parents, au trio qu’ils forment avec Marianne. Il regarde tous ses personnages avec affection, montrant une communauté solidaire balayant les différences sociales ou les préjugés sexuels. Des comportements symbolisés par une Sandrine Kiberlain solaire, expliquant à son fils qu’il ne faut pas avoir peur et que tout s’efface quand on est amoureux. Le film de Dalibor Matanic, qui avait reçu le prix du jury de la section Un certain regard lors du dernier Festival de Cannes, s’étend sur une période de vingt ans, de 1991 à 2011. Il est divisé en trois parties, dans le contexte dramatique né du conflit serbo-croate.
Le film de Dalibor Matanic, qui avait reçu le prix du jury de la section Un certain regard lors du dernier Festival de Cannes, s’étend sur une période de vingt ans, de 1991 à 2011. Il est divisé en trois parties, dans le contexte dramatique né du conflit serbo-croate. Dix ans plus tard, en 2001, une mère et sa fille Natacha retournent vivre dans la maison familiale détruite, à l’image d’un pays où il faut tout reconstruire. Elles confient les travaux à Ante, d’une nationalité différente. En colère Natacha cherche d’abord à l’éviter. Ante fait son boulot, apparemment indifférent à la jeune fille. Mais dans ce huis-clos sous tension sexuelle, ils tentent un rapprochement, comme pour oublier les blessures de la guerre.
Dix ans plus tard, en 2001, une mère et sa fille Natacha retournent vivre dans la maison familiale détruite, à l’image d’un pays où il faut tout reconstruire. Elles confient les travaux à Ante, d’une nationalité différente. En colère Natacha cherche d’abord à l’éviter. Ante fait son boulot, apparemment indifférent à la jeune fille. Mais dans ce huis-clos sous tension sexuelle, ils tentent un rapprochement, comme pour oublier les blessures de la guerre.