 Dans ce long métrage qui commence par un baptème et se termine par un enterrement, symbole de la fin d’un cycle et du début d’un autre, Basil Da Cunha suit les déambulations du jeune Spira (le beau Michael Spencer). Après avoir passé huit ans dans un centre pour mineurs, il retrouve sa famille et ses potes en revenant à Reboleiria un bidonville de la banlieue de Lisbonne voué à la démolition, où le réalisateur vaudois d'origine portugaise vit depuis dix ans.
Dans ce long métrage qui commence par un baptème et se termine par un enterrement, symbole de la fin d’un cycle et du début d’un autre, Basil Da Cunha suit les déambulations du jeune Spira (le beau Michael Spencer). Après avoir passé huit ans dans un centre pour mineurs, il retrouve sa famille et ses potes en revenant à Reboleiria un bidonville de la banlieue de Lisbonne voué à la démolition, où le réalisateur vaudois d'origine portugaise vit depuis dix ans.
Le retour de Spira, à la recherche d’un travail, rêvant d’un futur qui n’a pas grand-chose à lui offrir, n’est pourtant pas du goût de Kikas, un vieux trafiquant. Il lui fait comprendre qu’il n’est pas le bienvenu dans ce quartier à deux pas du centre de la capitale envahie par les touristes, où les habitants désoeuvrés, rejetés par le capitalisme, se débrouillent comme ils peuvent pour survivre. Ce sont les voisins et amis du cinéaste, qui en montre à la fois les côtés humains et brutaux.
S’inspirant de leurs histoires, mêlant la réalité et la fiction en créant un univers parallèle, le cinéaste dresse dans O Fim do Mundo le portrait d’une jeunesse meurtrie, à travers des personnages dont on a volé l’enfance. Ils ont perdu leur innocence et prônent les vertus du crime à l’ancienne.
Humaniste, l’auteur aime valoriser, mettre en lumière des gens qui ne le sont pas, leur donner de la visibilité à travers le cinéma, leur rendre une dignité et une parole qu’on leur refuse. Dans cette favela il magnifie les habitants, à l'image de Spira qui, tel un ange noir, la traverse en essayant de voir plus loin en dépit d'un avenir bouché. «J’ai voulu faire un film de résistance, sur la fin d’un monde, d’un quartier, d’une génération, représenté par cet endroit, un des derniers maquis où on peut vivre autrement.»
Pour lui, c’est une résistance à la normalisation qui lui fait peur, à la modernité. «Même si elle s’immisce à travers quelques téléphones portables, il y a une volonté de ne pas rester rivé à son ordinateur.» Comme dit l’un de ses personnages, ce n’est pas de cette manière qu’on va conquérir le monde ou se faire de l’argent.
A l’affiche dans les salles de Suisse romande dès mercredi 11 mars.
 Effie Alexandra, Söan et Logan sont nés dans le mauvais corps. Avec des attributs qui ne correspondent pas à ce qu’ils sont. Obsédés par ce qui leur manque ou ce qu’ils ont en trop, par le regard de l’autre, par le dire ou le cacher. Pendant plus de deux ans, le Genevois Robin Harsh, se mettant à la place du spectateur, du parent ou du jeune qui se pose une foule de questions, a suivi ces trois adolescents sur le long et douloureux chemin de la transition, le grand bouleversement qu’elle provoque chez eux, leurs parents, les difficultés qu’elle entraîne à l’école et dans la société.
Effie Alexandra, Söan et Logan sont nés dans le mauvais corps. Avec des attributs qui ne correspondent pas à ce qu’ils sont. Obsédés par ce qui leur manque ou ce qu’ils ont en trop, par le regard de l’autre, par le dire ou le cacher. Pendant plus de deux ans, le Genevois Robin Harsh, se mettant à la place du spectateur, du parent ou du jeune qui se pose une foule de questions, a suivi ces trois adolescents sur le long et douloureux chemin de la transition, le grand bouleversement qu’elle provoque chez eux, leurs parents, les difficultés qu’elle entraîne à l’école et dans la société.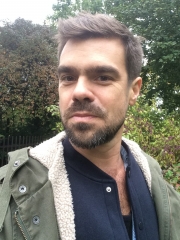 Robin Harsch, 42 ans, auteur de plusieurs courts métrages et de documentaires pour la télévision, s’est lancé dans l’aventure par hasard. « En 2015, une amie me parle de la création du Refuge à Genève, un centre qui permettra à des adolescents LGBTIQ+ de venir parler de leurs problèmes en lien avec leur préférences sexuelles ou leur identité de genre. Je me suis dit que cela ferait un bon thème de documentaire.»
Robin Harsch, 42 ans, auteur de plusieurs courts métrages et de documentaires pour la télévision, s’est lancé dans l’aventure par hasard. « En 2015, une amie me parle de la création du Refuge à Genève, un centre qui permettra à des adolescents LGBTIQ+ de venir parler de leurs problèmes en lien avec leur préférences sexuelles ou leur identité de genre. Je me suis dit que cela ferait un bon thème de documentaire.» Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands sont aux portes de Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle (Lambert Wilson, photo) qui vient d’être promu général, est convaincu que tout espoir n’est pas perdu, qu’il faut s’opposer au maréchal Pétain et continuer le combat. Sa femme Yvonne (Isabelle Carré) est son premier soutien, mais très vite les événements les séparent. Charles rejoint Londres où il prononcera son fameux appel du 18 juin sur les ondes de la BBC.
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands sont aux portes de Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle (Lambert Wilson, photo) qui vient d’être promu général, est convaincu que tout espoir n’est pas perdu, qu’il faut s’opposer au maréchal Pétain et continuer le combat. Sa femme Yvonne (Isabelle Carré) est son premier soutien, mais très vite les événements les séparent. Charles rejoint Londres où il prononcera son fameux appel du 18 juin sur les ondes de la BBC.